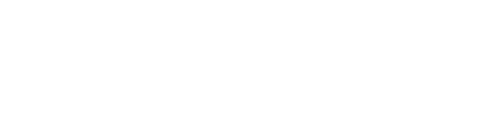CINQ ARTISTES OEUVRENT POUR L’ENVIRONNEMENT
Wadi MHIRI, Houda GHORBAL, Hela LAMINE, Sana TAMZINI, Mouna JEMAL SIALA
Jean LANCRI
….
Face Í Gaͯa.
(Vingt-et-une petites notes pour cinq artistes en mal de Terre)
1) A en croire les experts en matière de climat, nous devrions tout tenter pour réduire, sinon oblitérer, les méfaits que nous avons causés Í notre environnement. Il y va de notre responsabilité au regard des générations futures ; Í plus ou moins long terme, sans doute y va-t-il même désormais de la survie de l’espèce humaine.
2) Face Í cette crise sans précédent dans l’histoire, que faire quand on s’occupe d’art ? Face Í la face de Gaͯa défigurée par l’égarement de ses enfants dénaturés, serait-il vain de continuer Í besogner artistiquement dans ce monde ?
3) Pour des artistes qui consacrent leur énergie Í batir une « œuvre », est-il possible, dans de telles circonstances, de rester sourd aux doléances de la planète, aux exigences chaque jour plus pressantes de la « Terre-Mère » ? Comment ne pas essayer de leur donner suite tout en faisant le grand écart, c’est-Í -dire rien qu’en « œuvrant » sur le terrain de l’art ?
4) A tout le moins, nous disent certains, pourrait-on commencer par effacer les immondices dont la face du monde a été si malencontreusement couverte. « Il y a une taie sur l’œil de la beauté » écrivait naguère René Char. A l’art de s’employer pour l’enlever.
5) Cinq artistes tunisiens relèvent donc aujourd’hui le défi. Ils font face. Devant l’urgence climatique, ils ont décidé de faire front et front commun : depuis le front de l’art. Unis comme les cinq doigts de la main, ils mettent en jeu les enjeux des problèmes qui se posent tant Í nous qu’Í eux en intervenant depuis le champ cinq fois singulier de leur pratique personnelle. Empruntant pour ce faire des voies obliques propres Í l’art, ils effectuent de concert ces pas de cÍ´té qu’autorise dans nos sociétés la posture dite de l’artiste; ce dont témoigne exemplairement l’exposition qui les réunit en ce moment Í la galerie Musk & Amber de Tunis.
6) Mais, objectera-t-on, que peut leur art devant l’ampleur des problèmes Í résoudre ? Voici leur réponse : si l’art ne peut rien au plan des décisions collectives qu’il conviendrait d’adopter (c’est la part qui revient au politique), il peut tout, néanmoins, au plan du symbolique.
7) En effet, ne peut-on penser que, si nous n’avons rien fait devant la catastrophe annoncée, c’est parce que les intérêts en jeu n’ont pas été suffisamment représentés ? Or, les mettre en représentation pour les rendre davantage présents Í l’esprit, tel n’est-il pas le rÍ´le dévolu Í l’art ?
8) Telle est la question que Hela Lamine, Houda Ghorbel, Mouna Jemal, Sana Tamzini et Wadi Mhiri ont l’ambition de poser ; plus encore : d’exposer au cœur de leur cité. La mettre en éclat et dans tous ses états est l’honneur de leur art.
9) Souhaitons Í ce quintette d’artistes ainsi constitué pour le meilleur, souhaitons-lui de provoquer une salutaire prise de conscience ! De faire comprendre aux visiteurs de leur exposition que prendre Í bras-le-corps la crise écologique actuelle suppose des modalités neuves du « vivre ensemble » ; au premier rang desquelles figure, comme nous l’enseigne Í longueur d’ouvrages le philosophe Bruno Latour, la prise en compte, pour une alliance d’inédite nature, d’un nouvel acteur de hautaine et souveraine stature: Gaͯa. Car ne dit-on pas de l’art qu’il est ce drÍ´le de « polisson » que toute « polis » digne de ce nom fomente en son sein et pour son bien ? Or lui seul a la capacité de jouer, dans les règles, contre les règles. Lui seul peut alors nous amener Í les amender en douceur.
10) C’est ainsi que l’art possède le pouvoir de contrer, sans violenter qui que ce soit, un geste d’anodine apparence mais de funeste conséquence, celui qui consiste Í négligemment jeter des détritus sur une plage. Dans le Groupe des Cinq, Hela Lamine nous en fournit l’exemple le plus manifeste lorsqu’elle assortit ce geste anonyme (celui du jet des ordures) d’un geste second: le sien. Ainsi commence-t-elle par photographier des rivages souillés (ceux de Kerkennah, en l’occurrence), établissant de la sorte un relevé des effets désastreux du geste premier. Mais un relevé n’est pas une relève. Aussi agrémente-t-elle ses photos de dessins saupoudrés au sel de son humour et de sa fantaisie. Et c’est ainsi que des plages jonchées de déchets se trouvent élevées au rang de pages dignes d’être exhibées dans une galerie dédiée Í l’art : pour les plaisirs de l’œil et la gouverne des esprits.
11) D’un geste, l’autre ! Du premier au second, une inversion ne s’est-elle pas produite ? En passant de la plage Í la page, n’a-t-on pas permuté le moins en plus ? Certes, on n’aura guère changé l’ordure en or pur ; mais on aura hissé sa mise en représentation au rang de l’art. Moyennant quoi, peut-être y aura-t-il eu ce surcroÍ®t : la surprise d’une prise de conscience, la conscience d’un geste Í proscrire. Or ce qui prévaut pour Hela ne vaut-il pas également, peu ou prou, pour Houda, Mouna, Sana et Wadi ?
12) Prenons Wadi. Que nous montre-t-il ? Des torses ; des « sculptures » de corps dépourvus de têtes et de membres. Des moulages de torses réduits Í une peau qui, pour peu que l’on tourne autour d’eux, retourne, tel un gant, le convexe en concave, alterne l’endroit et l’envers, commute l’extérieur et l’intérieur. Or que discerne-t-on Í fleur de cette peau ? Des impacts de balles (sur les corps, s’ils sont vus du dehors), des impacts qui provoquent (Í l’intérieur des torses) des efflorescences en voie de s’épanouir. Virevolter autour des troncs revient donc Í renverser le moins en plus ; et le mal en bien : les blessures infligées au « Grand Corps Malade » de chacun des troncs n’ont-elles pas donné naissance Í l’exubérance d’une floraison ?
13) Poursuivons notre visite ; Í l’instar de Hela et Wadi, Houda, Mouna et Sana ne sont pas en reste pour nous engager dans l’optimisme d’une série d’inversions qui changent le sens des signes. La première (Houda) allonge démesurément ses toiles selon un axe vertical, telles d’insolites colonnes vertébrales. Elle en fait des lits dressés vers le firmament, vers des « ciels » de lits. Des lits propices aux rêves ; o͹ cohabitent animal et végétal, fleurs et feuillages, fils et dessins, coulures et coutures. Des lits o͹ l’artiste a couché de multiples fragments du « grand corps malade » de la Nature afin qu’une transe soit Í même de s’y faufiler : pour les coaguler, ces vertèbres disparates, en colonnes ascendantes. Pour les transcender dans une « transvertébration » tendue telle une adresse au ciel.
14) La troisième (Sana) part, quant Í elle, de ce ciel pour y pendre son œuvre comme Í une patère. L’artiste a, en effet, suspendu aux cintres de la galerie une installation de grande envergure mais de frêle allure qui n’est pas sans convoquer tout un pan récent de l’histoire de l’art ; sans rappeler un mobile de Calder. Avec cette différence que son mobile Í elle se veut Í la fois arachnéen et « high-tech » : réduit aux quelques fils qui relient entre eux des cadres numériques (o͹ les malheurs qui obèrent l’avenir de notre terre défilent en boucle) et des écrans tactiles (disposés en lévitation au dessus du sol, comme autant d’exhortations Í y mettre nos doigts ; pour nous inciter Í intervenir, en toute utopie, sur notre futur). Ainsi l’installation de Sana se déploie-t-elle en oscillant dans l’espace de la galerie non plus au gré du vent (comme c’était le cas chez Calder) mais sous la poussée des doigts des visiteurs : le destin de notre planète y serait lÍ mis Í la portée de chacun ; autant dire qu’il est entre nos mains. A ces visiteurs, toutefois, de ne pas oublier que, via leurs doigts et par le moyen des tablettes, le dialogue reste Í instaurer, sinon avec le Très-Haut, du moins avec lÍ -haut. Puisque toute l’installation y est accrochée, tout ne dépend-il pas ici du ciel? Par voie de conséquence, les interventions sur les écrans tactiles ne sont-elles pas Í interpréter tels autant de vœux pieux Í lui adressés ?
15) Il revient Í la dernière de notre énumération (c’est-Í -dire Í Mouna) d’avoir mis le doigt, par le biais de ses titres, sur la nature particulière des objets exposés tant par elle que par ses compagnons. Car les œuvres présentes chez Musk & Amber ne sont pas que des objets candidats Í une appréciation esthétique ; Í proprement parler, ne sont-elles pas également des ex-voto ? A bien les examiner, n’ont-elles pas, toutes, été produites « Í la suite d’un vœu » ?
16) « Poubelle dorée » : voici, par exemple, ce que nous donne Í lire Mouna, sur le cartouche de l’une de ses œuvres. Et voici ce que nous montre celle-ci: une vulgaire poubelle ; achetée par l’artiste dans une quelconque quincaillerie, ainsi que l’aurait fait, au siècle dernier, un Marcel Duchamp en mal d’œuvre, en recherche de quelque readymade, en vadrouille dans les allées du Bazar de l’HÍ´tel de Ville, Í Paris. A son instar, Mouna ne nous montre guère plus qu’une poubelle ordinaire mais c’est une poubelle qu’elle a dorée Í l’or fin ; Í seule fin, semble-t-il, de nous inviter, elle aussi, Í passer du moins au plus. N’y aurait-il pas gros Í gagner, en effet, Í envisager de l’or pur au-delÍ d’une poubelle synonyme de l’ordure ? Ce faisant, Mouna nous engage dans un dialogue avec l’histoire de l’art. Conceptuellement, sa poubelle n’est pas qu’un hommage rendu Í Duchamp ; n’est-elle pas, aussi, enduite Í l’or de Byzance ? Est-il nécessaire, pour faire briller davantage la dorure de cette « sacrée » poubelle, est-il nécessaire de rappeler que, dans les mosaͯques byzantines, l’or des auréoles symbolisait la « gloire » de Dieu ?
17) Tout comme cette « Poubelle dorée », les œuvres rassemblées par le Groupe des Cinq afin de faire front commun dans la bataille pour l’environnement, des œuvres actuellement données Í voir chez Musk & Amber, ne participent-elles pas, Í des degrés divers, d’un même acte, d’un même don, d’un même vœu qui serait adressé, sinon au Ciel et Í Dieu, du moins Í un acteur majeur s’il en est, nouvellement arrivé sur la scène de l’histoire humaine ; Í savoir : Í la Terre ?
18) Mais pour lui dire quoi ? Faisons un écart de langage : passons par le latin.
19) « Do ut des. » Traduisons : « Je donne pour que Tu donnes ». Ce « don » d’une œuvre, donnée Í contempler par nos contemporains (pour les amener Í penser plus), ne serait pas donné qu’Í ceux-ci ; il serait prioritairement donné Í la Terre : en attente d’un contre-don de sa part. Ainsi relèverait-il de l’adage qui réglait certains usages dans la Rome antique ; un adage qui, si l’on en croit Didi-Huberman, règlerait aussi la pratique universelle de l’ex-voto.
20) Glosons : « (Moi, Hela, Houda, Mouna, Sana, Wadi) je donne (la représentation symbolique d’un mal fait Í la nature) pour que Tu donnes (la réalité de ce bienfait que serait l’effacement de nos méfaits) ». Ainsi « parlent » les œuvres du Groupe des Cinq ; ainsi parlent-elles Í la Terre dès lors qu’elles mélangent l’espace de l’art et l’espace du sacré (« Truelles sacrées » n’est-il pas le titre d’une série d’œuvres exposées par Mouna ?). Elles sont une adresse solennelle, Í Gaͯa, d’abord, aux hommes et aux femmes de bonne volonté, ensuite.
21) « Tunisiens, encore un effort ! » se permettent de murmurer, chez Musk & Amber, les œuvres de cinq artistes entrés en résistance pour la défense de l’environnement. Fasse le ciel que grandissent leurs échos : encore un effort pour demeurer fidèles au Printemps tunisien, pour être révolutionnaires au sens fort : face Í Gaͯa !
Jean Lancri .
Awatef Khadhraoui
….
De la nature Í la culture
Notre environnement, c'est notre support de vie avec toutes ses composantes : l'air, l'eau, l'atmosphère, les végétaux, les animaux... Notre environnement, élément clé de notre survie, est dangereusement affecté par nos activités, et nos milieux sont massivement pollués ; ce qui n’est pas sans avoir un effet, direct ou indirect, sur les processus écologiques, les activités humaines ainsi que sur la qualité de vie.
L'environnement a été une source d'inspiration inépuisable pour l'homme en général, et pour l’artiste en particulier. Les représentations d'animaux ou de paysages jalonnent l'histoire de l'art, que ce soit en Extrême-Orient, notamment en Chine et au Japon, ou en Europe Í partir de la Renaissance. De nombreux peintres seront qualifiés ultérieurement de paysagistes, tant parmi les romantiques que parmi les impressionnistes. Plus tard, les éléments environnementaux seront toujours présents dans les nouvelles formes d'art ( le Land Art ou l’Arte Povera) et avec les nouveaux processus, comme la photo et le cinéma. Plus récemment, des artistes ainsi que des personnalités du monde politique se sont mis Í utiliser l'art pour sensibiliser la population Í la défense de l'environnement : c'est le cas par exemple d'Al Gore, ancien vice-président des Etats Unis sous Bill Clinton, devenu cinéaste et militant écologiste très actif, qui réalisa un film An inconvenient truth, ou le photographe Yann-Arthus Bertrand.
En Tunisie, il y a quelque temps, on voyait un peu partout des statuettes représentant un personnage appelé Labib, une mascotte dont on a fait l’emblème du Ministère de l’Environnement. Le but de l’opération était de sensibiliser la population au respect de l’environnement, en sensibilisant le citoyen Í ne pas jeter les déchets n’importe o͹. La campagne de Labib n’a malheureusement pas atteint ses objectifs. Plusieurs raisons l’explique, entre autre l’absence de poubelle en nombre suffisant pour recevoir les déchets domestiques et industriels. Et lorsqu’on en trouve une, elle déborde ou est renversée. Aujourd’hui, la mascotte de Labib a disparu pour des raisons pas nécessairement avouables et il n’y a plus de rues, d’avenues ou de boulevards auxquels on donne le nom d’environnement.
L’état de notre environnement s’est beaucoup dégradé, ce qui n’a laissé personne indifférent.
Les artistes tunisiens contemporains, en tant que citoyens de ce monde et appartenant Í ce petit pays qu’est la Tunisie, ne cessent, depuis quelques temps, d’exploiter de nouveaux territoires artistiques, hors des sentiers battus. Cinq d’entre eux ont décidé d’œuvrer pour l’environnement. Si l’adjectif « Barcha » en arabe « الأرض البرشاء » signifie littéralement la terre fertile, en dialecte tunisiens, il exprime le trop et le surplus : un trop qui tue.
Cette exposition qui traite le thème de l’environnement en Tunisie, présentée par les artistes ; Mouna Jemal, Wadi Mhiri, Sana Tamzizni, Houda Ghorbel et Hela Lamin, qui ont décidé de s’exprimer dans l’analyse et la provocation avec des photos, de la peinture, l’installation et des objets empruntés de leur contingence pour exprimer le monde autrement. Ces artistes, jeunes et moins jeunes, décidés dans leur démarche s’arment d’art mÍ»r en guise d’armure contre la détérioration de notre environnement Í la fois local et global.
La Dérision
Le mot environnement est polysémique, c'est-Í -dire qu'il a plusieurs sens différents. Ayant le sens de base de ce qui entoure, il peut prendre le sens de cadre de vie, de voisinage, d'ambiance, ou encore de contexte.
Hela Lamine, artiste pluridisciplinaire, s’intéresse Í l'environnement au sens d'environnement naturel qui entoure l'homme, un concept qui s'est développé Í partir de la seconde moitié du XXe siècle. Se déambulant, avec sa tablette Í la main, l’artiste ne cesse de prendre des photos.
Son projet « Rétinade 2.0 » s’est développé lors d’un séjour Í la « belle » Í®le de Kerkena. La benjamine des cinq a été surprise par la quantité d’ordures jetées sur la plage, au bord de la mer. Voulant prendre de « belles » photos de souvenir, Hela n’a pas pu éviter le paysage nauséabond, elle a décidé alors qu’il fera une partie intégrante de ses compositions. Hela re-recadre donc ses photos sur lesquelles les sacs en plastiques apparaissent comme des fleurs bleues qui garnissent les immondices. L’artiste en ajoute un dessin qui fait augmenter le degré de la dérision et de la contradiction.
Si au XIXe siècle, en Occident, le romantisme a mis en avant la beauté des paysages sauvages, parfois en les opposants aux paysages et Í la misère des mondes ouvriers, et industriels, Héla Lamine a mis en exergue cette contradiction pour nous faire prendre conscience que ce bien est précieux et devait être préservé.
Le Sacré
Mouna Jemal garnit ses poubelles, sa raclette et son balai de dorure et de strasses. A l’instar d’un Marcel Duchamp, Mouna Jemal a simplement décidé que ces objets anodins et banals et qui nous renvoient au dépotoir et aux excréments deviennent par l’acte créateur sacrés. Et Í l’instar d’un Damien Hirst, sans pour autant tomber dans la vanité, Mouna a recouvert ses objets sacrés par des diamants (bien sÍ»r des faux) et de feuille d’or, des objets bling bling pour montrer l’importance de ces objets dans l’entretien de notre environnement et pour dénoncer la situation lamentable des rues de la Tunisie post révolutionnaire.
Mouna, voulant critiquer ces conditions, a été obligée d’être ésotérique. Son engagement se cachait derrière des objets qui, avec le recul, nous incitent Í parler plutÍ´t d’« agency », au sens d’Alfred Gell, de l’objet utilisé par l’artiste pour désigner un nouveau rapport au monde. Les objets devenaient des protagonistes qui jouaient des rapports humains et sociaux nouveaux sur le registre de l’utopie
Enfin, une poubelle recouverte de diamants et de dorures vaut-elle plus qu’une boite Í ordure ?
L’Heure de leurre
Les humains ont créé des parcs nationaux pour préserver l’environnement écologique mais ont malheureusement créé aussi des guerres et des conflits qui ont causé la détérioration de l’humain. Si l’environnement nous renvoie généralement Í ce qui entoure l’homme, Wadi Mhiri a voulu s’intéresser Í l’homme lui-même. Les bustes de Wadi Mhiri, réduits Í une peau, nous renvoient Í cette contradiction dans le comportement des humains. Ses bustes en gré, de taille humaine, sont comme un médaillon Í double revers ; en avers, on trouve des fleurs et au revers une balle en plein cœur ou une chevrotine.
10. 35am, 16. 10pm et 11. 28am, c’est malheureusement ce qu’on garde d’une tuerie, l’heure, avec le nombre des victimes.
Les œuvres de Wadi, reflètent l’actualité dans laquelle nous vivons ; on se réveille et on dort en comptant le nombre des corps et en ramassant les cadavres honteusement et faussement au nom d’Allah, de la démocratie et de la liberté. La pollution médiatique qui nuit Í notre environnement sensoriel et émotionnel a banalisé complètement la violence.
La Métamorphose
Pour sa part Houda Ghorbal, s’est mise dans la peau d’un styliste ; elle a coupé, collé, cousu, peint et enveloppé de résine.
Métamorphose et personnification sont les maÍ®tres mots de l’œuvre de Houda. Dans un monde utopique, créé Í partir d’éléments disparates, l’artiste crée ses photomontages Í partir de composition d’éléments hybrides qui nous renvoie Í une sorte de figuration o͹ expressionnisme, surréalisme et spiritualité, se mêlent Í une revendication sociale et politique. L’effet glaçage avec de la résine donne l’impression du fini et du parfait mais, aussi, nous renvoie l’idée de l’enveloppement et de la protection.
L'idée d'une dégradation de l'environnement de la Terre dans laquelle vivent les humains, par l'effet de la pollution, est devenue représentative d'une dégradation du milieu habitable ainsi que la faune et la flore, et c’est tout l’enjeu de l’œuvre de Houda.
Le Vacarme
Tel un Calder, l’installation de Sana Tamzini est composée d’un Stabile et d’un mobile. Sous forme d’une structure métallique qui prend la forme d’un arbre métallique, garni de sept écrans numériques et deux tablettes tactiles. L’arbre numérique de Sana fait défiler en boucle des photos qui représentent la détérioration de notre environnement avec un enregistrement de la pollution sonore qui nuit Í notre quotidien. Accrochée telle une suspension, elle n’attend que l’intervention du spectateur pour osciller. Avec son installation spatio-numérique, Sana instaure un dialogue entre l’œuvre, le spectateur et la nature (représenté en abÍ®me).
Fidèle Í ses habitudes, Sana a exploité des éléments issus d’expérimentations et de réflexions sur la notion d’immatérialité qui combine, cette fois, le High-tech et l’espace dans la création artistique et des pratiques tournées vers les nouvelles technologies. La transparence de l’installation de Sana Tamzini et l’utilisation du procédé numérique conquit l’espace et le spectateur, partie prenante de l’œuvre qui, pris au piège, il devient une partie intégrante de l’œuvre.
Le parcours numérique de Sana Tamzini se situe dans une forme d’aventure spatio-lumino-numérique et sonore. L’artiste mélange le tout dans un espace qu’elle s’approprie.
Disons en conclusion que l’environnement est un bien commun, que nous avons le devoir de soigner et de sauvegarder pour le léguer intact aux générations futures. Comme l’a si bien dit un citoyen d’Ottawa en 1954, Í chaque jour que nous détruisons un peu plus notre environnement, nous nous engageons un peu plus sur la voie du suicide collectif.
Chaque être humain est désormais la cible volontaire ou involontaire d’évènements qu’il n’a pas forcément choisis mais les traces laissées sur son corps sont absolument éternelles.
Wadi Mhiri
L’art s’interroge, murmure des trouvailles. L’œuvre se déploie, s’installe dans l’espace majestueuse …
Sana Tamzini
Je les nomme « objets sacrés », car détournés de leur fonction première qui est toute simple, mais Oh ! Combien importante. Je les sacralise, je les élève au rang de l’Art.
Mouna Jemal Siala
Des silhouettes cousues sur toile apparaissent et prennent vie dans un monde o͹ les roses sont remplacés par les épines, les oiseaux par les serpents et l’humanisme par le terrorisme…
Houda Ghorbel
Ma première réaction était de changer de cadrage, cherchant ailleurs un paysage préservé de l’homme, privilégiant peut être plus les nuages et le ciel bleu Í la terre devenue trop polluée.
Héla Lamine