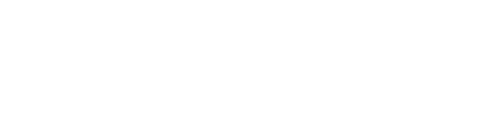En présence de sa réalisatrice Jacqueline Caux, cinéaste et écrivaine française, le documentaire : « Si je te garde dans mes cheveux » a été projeté le 3 mai au Centre des musiques arabes et méditerranéennes « Ennejma Ezzahra », Í Sidi Bou Saͯd. Etrangement, seulement une quinzaine de spectateurs étaient au rendez-vous, ce soir-lÍ ! Les absents avaient eu tort et les présents avaient eu droit Í une délectation et Í un bain de jouvence.
Il s’agit, en effet, d’un voyage fabuleux autour de quelques femmes musiciennes et chanteuses arabes actuelles connus et moins connues ; celles-lÍ mêmes qui ont bravé les obstacles et les interdits pour s’affirmer et faire valoir leur art musical dans des sociétés arabes machistes du Maghreb au Machrek.
La projection a été précédée par l’écoute d’un extrait d’une émission radiophonique o͹ le défunt Daniel Caux, musicologue, essayiste, journaliste, critique musical, homme de radio et organisateur d’événements musicaux et mari de Jacqueline Caux parle de la musique arabe.
Sa femme vient de sortir un livre des écrits de Daniel Caux, alias «Ali Charlie » sur les musiques arabes. Le générique de début nous montre notre musicienne Amina Srarfi jouant de son violon sur la scène du Théatre municipal de Tunis, sans la présence du public. Ce film d’une heure cinq minutes commence au Maroc, dans le Haut Atlas avec la chanteuse berbère Hadda Ouakki qui raconte en dialectal marocain son aventure avec le chant dès son plus jeune age. Illettrée, mais attachée Í sa culture berbère, elle la chante et chante l’amour d’une voix veloutée et endiablée.
Des chants et « Ouroubi » représentatifs de sa culture et de son milieu. Nous la suivons dans son quotidien et au cours de ses répétitions accompagnée d’un orchestre formé de musiciens hommes. Ses mains sont parées de Hénné et son accoutrement est dans la pure tradition marocaine. Une femme et une chanteuse exceptionnelle.
Puis, c’est autour d’Amina Srarfi et de sa troupe d’ « El Azifet », première troupe de femmes musicienne dans le monde arabe qu’elle a créé depuis vingt ans, qui apparait. Amina y parle dans un français éloquent de son parcours musical aux cÍ´tés de son père le musicien, compositeur et chef d’orchestre de la Rachidia : Kaddour Srarfi.
Des extraits du Malouf tunisien y sont chantés par « El Azifet » filmées au cours d’une séance de répétition au Conservatoire Kaddour Srarfi. La réalisatrice axe sur les gros plans et les expressions des visages et filme les rues de Tunis au quotidien sans musique, ni paroles, avec seulement le son des ambiances prises sur le vif.
Des clins d’œil y apparaissent avec un graffiti sur « Femen Tunisie », lÍ o͹ une autre Amina en avait eu marre des interdits et des pressions pour s’inscrire dans ce mouvement international et le crier haut et fort. La femme tunisienne n’a-t-elle pas toujours été indomptable et rusée ? Depuis Elyssa, Í la Kahéna, Í Aziza Othmana, Í Essaida El Manoubia, Í B’chira Ben Mrad, aux sœurs Meherzia, Zbeida, Khira et Mongia Amira, Í Radhia Haddad, Í Alia Babbou (Saͯda Alia)…
Des extraits du Malouf tunisien y sont chantés par « El Azifet » filmées au cours d’une séance de répétition au Conservatoire Kaddour Srarfi. La réalisatrice axe sur les gros plans et les expressions des visages et filme les rues de Tunis au quotidien sans musique, ni paroles, avec seulement le son des ambiances prises sur le vif.
Des clins d’œil y apparaissent avec un graffiti sur « Femen Tunisie », lÍ o͹ une autre Amina en avait eu marre des interdits et des pressions pour s’inscrire dans ce mouvement international et le crier haut et fort. La femme tunisienne n’a-t-elle pas toujours été indomptable et rusée ? Depuis Elyssa, Í la Kahéna, Í Aziza Othmana, Í Essaida El Manoubia, Í B’chira Ben Mrad, aux sœurs Meherzia, Zbeida, Khira et Mongia Amira, Í Radhia Haddad, Í Alia Babbou (Saͯda Alia)…
Le passage vers l’Egypte a été avec Oum Kalthoum et un extrait d’archives d’un concert en public et en noir et blanc. Amina Srarfi y apporte son témoignage pour axer sur la détermination de l’ « Astre de l’Orient » Í chanter même habillée en garçon, Í ses débuts accompagnée de son père. Sa fréquentation du milieu des grands musiciens de l’époque lui a en plus permis d’apprendre Í mieux chanter dotée d’une voix d’or.
Elle ne tardera pas Í chanter les compositions des plus grands compositeurs du monde arabe, Í l’instar de Mohamed Abdelwahab et particulièrement Baligh Hamdi, qui était son plus jeune compositeur. Son passage Í l’Olympia en 1967 demeure d’anthologie o͹ la communauté arabe de France s’y était donné rendez-vous.
Elle ne tardera pas Í chanter les compositions des plus grands compositeurs du monde arabe, Í l’instar de Mohamed Abdelwahab et particulièrement Baligh Hamdi, qui était son plus jeune compositeur. Son passage Í l’Olympia en 1967 demeure d’anthologie o͹ la communauté arabe de France s’y était donné rendez-vous.
Du cÍ´té syrien, la réalisatrice a rencontré Waed Bouhassoun, une musicienne et chanteuse engagée qui s’est exilée en France après les événements survenus dans son pays. Il en est de même pour la palestinienne Kamilya Jubran qui vit également en France, sans toutefois ne pas chanter ailleurs dans les pays arabes et en Palestine. La réalisatrice est allée filmer Í El Qods avec le même rythme de narration celui de prendre les gens dans leur quotidien sans retouches, ni paroles.
Au cours du débat qui s’ensuivit, Jacqueline Caux a fait rappeler que les femmes ont joué un rÍ´le important durant « le printemps arabe. » Elle a puisé le titre de son documentaire d’un poème d’Ibn Arabi. Elle a annoncé d’autre part que son film sera projeté le 31 mai Í Saint-Etienne.
Il a été déjÍ projeté le 23 avril au Palais Chaillot, Í Paris. « Jetset » lui a demandé pourquoi elle ne s’était pas rendue en Egypte ? Elle a répondu qu’elle n’avait pas eu les moyens de le faire, vu qu’elle est une cinéaste indépendante, donc qui travaille pour son propre compte. Et Í une autre question de « Jetset » si le film a été projeté dans d’autres pays arabes, la cinéaste a répondu que c’est la première fois qu’il est projeté dans un pays arabe.
Il a été déjÍ projeté le 23 avril au Palais Chaillot, Í Paris. « Jetset » lui a demandé pourquoi elle ne s’était pas rendue en Egypte ? Elle a répondu qu’elle n’avait pas eu les moyens de le faire, vu qu’elle est une cinéaste indépendante, donc qui travaille pour son propre compte. Et Í une autre question de « Jetset » si le film a été projeté dans d’autres pays arabes, la cinéaste a répondu que c’est la première fois qu’il est projeté dans un pays arabe.
B.L.