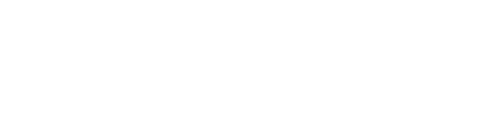Alajuela, San José, direction Limon, Puerto Viejo. Six heures de route pour faire 250 km, pour serpenter entre les montagnes aux sommets nuageux, les volcans aux cratères nerveux. Six heures de route sans indications ou presque. Nature luxuriante, forêts tropicales, paysages qui défilent et défient un œil trop peu habitué. Des piétons, faute d’espace grignoté par la nature, marchent au bord de la route. Des vélos aux guidons très longs et larges circulent lentement. Une pluie torrentielle s’abat tout d’un coup pour laisser le soleil réapparaÍ®tre quelques instants après. La nuit tombe vite Í mesure que les virages s’accentuent. Des cratères dans la route font bondir la voiture et manquent de nous projeter. Seraient-ce les dernières éruptions qui en sont responsables ? Mystère. Les kilomètres défilent Í un rythme lent. Pura vida ! Nous arrivons Í destination, exténués. Petit coin de rastafari, musique reggae berçante, les gens, nonchalants, se baladent. Les femmes, jeunes, vieilles, belles, moches, grosses, minces, brunes, noires, blondes arborent fièrement un minishort et une petite camisole au décolleté étourdissant. Odeur de marijuana, de rhum, d’air salé, de nature fraÍ®che et humide. Humer cet air et raviver ses poumons, fermer les yeux et se laisser emporter par cette ambiance zen. Pura vida. Pas facile de se diriger dans les petits sentiers du début de la jungle.
Le lendemain matin, réveillé par les impressionnants hurlements de singes qui retentissent dans les quatre coins de la jungle Í cinq heures du matin, je commence Í lire. Puis je ferme le livre. Non, je ne veux pas faire mon Gide au Congo. René, qui se fait appeler Juan pour se donner une couleur locale alors qu’il baragouine Í peine quelques mots en espagnol, me propose de faire un petit tour et de me montrer les bons spots. Je grimpe dans le pick-up et la même odeur de sueur imprégnée cette fois-ci dans les sièges de l’auto me coupe le souffle net. On fait deux cents mètres – ici, tout se calcule au mètre près, sinon tu te perds – et on s’arrête. On descend et René pointe un arbre d’une longueur interminable. Je ne vois rien. Il me précise o͹ regarder. Toujours rien. Je n’ai pas encore l’œil. Je finis par remarquer un paresseux qui glande sur une branche. Il fait Í peine un mouvement par heure. Très curieuse rencontre. On s’enfonce dans la forêt et, après quelques foulées, une magnifique plage bordée de cocotiers s’étend devant mon regard incrédule et ébahi. A gauche, quelques vautours semblent attendre.
- Ils attendent qu’on meure, me lance René avec un sourire cynique. Il fait quelques pas et ramasse un fruit tombé par terre. Un mélange entre une patate et une figue de barbarie. C’est un nenni, me dit-il. Il le presse pour qu’il s’ouvre et me demande de le humer. Une odeur fétide s’en échappe, mais comme il semble enthousiaste de me faire découvrir un nouveau fruit, je me contente de lui dire que c’est spécial comme odeur.
- C’est spécial ! C’est dégueulasse ! Ça te donne envie de gerber. On dit que c’est un super médicament, mais il faut être très mal en point pour bouffer cette merde.
Je commence Í saisir le personnage. On rebrousse chemin et on reprend la route vers une autre plage. Je remarque Í ma gauche une machette calée entre mon siège et la boÍ®te de vitesse.
- C’est utile une machette ici ?
- Ah oui. Et je m’en sers souvent, lance-t-il sur un ton déterminé comme pour laisser planer un mystère.
Je regarde les Ticos, les Costaricains, passer sur le bord de la route.
- Et les rapports avec les gens ici se passent bien ?
Il ne me répond pas et arrête la voiture net au milieu de la piste. Il me montre un iguane couché sur une branche. Après, il m’indique quelques restaurants et une épicerie, tous tenus par des Européens : Français, Allemands, Suisses, etc. René, c’est le réseau européen. Je l’ai compris plus tard quand j’ai découvert le réseau américain.
- Mais les Ticos ne possèdent rien chez eux !
- Il fait une moue de dégoÍ»t. Non, ils n’aiment pas travailler.
Je regarde les gens marcher, ils nous saluent de la main avec un sourire, mais ils sont invisibles pour René.
Il est sept heures du matin et le soleil est bien planté au cœur du ciel. René se penche pour ramasser quelques noix de coco tombées la veille.
- Merde, ils ont tout bouffé, fait chier ! On est arrivé un peu tard. Si tu veux avoir la paix, il faut venir tÍ´t Í la plage, parce qu’après c’est la cohue. Il suffit de trouver trois ou quatre personnes et tu n’es plus en paix.
René est né au Gabon. Il est fils de colon et aime la nature sauvage. Nous quittons René sans regret et nous reprenons la route, sur un coup de tête, vers le Panama. Nous dévalons les pentes, épousons les courbes, surplombons les nuages, zigzaguons entre les cratères de la route. Des bananeraies, des champs d’ananas, de café et de cacao, bordés de cocotiers et d’arbres divers et inconnus pour moi, s’étendent Í perte de vue. Des hommes avec des machettes marchent tout le long de la route. Ils coupent l’herbe et la végétation qui veulent empiéter sur la chaussée. La population change de traits. Les gens sont trapus, aux traits typés, Í la peau tannée. Ce sont les descendants de ceux qui se sont fait appeler par erreur des Indiens, eux-mêmes descendants de Mongols venus il y a sept mille ans du Pacifique. Des cabanes sur pilotis sont éparpillées Í travers champs et plantations. Les maÍ®tres des lieux, les riches propriétaires, préfèrent garder leurs ouvriers sur place. Exploitation permanente d’un peuple que les conquistadors n’ont pas réussi Í exterminer. Ce sont les mêmes descendants d’Espagnols qui possèdent les terres. Ils fournissent une bonne partie du marché nord-américain et européen en café, cacao, bananes et ananas.
La physionomie des Panaméens est différente. Trapus, machoires saillantes, habillés comme des gangsters, ils ont le regard dur. Ils sont plus proches des Colombiens que des Ticos. Des images de la prison de la série Prison Break me sautent aux yeux. Le casting est fidèle Í la réalité. Le look typique du Panaméen : un tee-shirt ouvert sans manches, des tatouages sur les bras, une grosse chaÍ®ne en or, un short long et des baskets. Crane rasé et démarche de pitbull. Méfiez-vous des apparences.
Après deux jours passés Í visiter les différentes Í®les de Bocas del Toro, toutes aussi belles les unes que les autres et aussi bien conservées et épargnées du béton, parmi les jeunes Américains venus surfer et plonger, retour au Costa Rica qui nous manque déjÍ . La pura vida nous rappelle.
Pamela dit qu’elle est née aux États-Unis, a grandi au Panama et vit maintenant depuis vingt ans au Costa Rica. Elle tient un bed and breakfast, fait une excellente confiture de carambole, des bananes plantains flambées, déteste la politique américaine qui l’a fait quitter ce pays-lÍ et voue une admiration profonde Í son pays d’accueil. Elle a les yeux bleu clair, un sourire qui laisse voir de belles rides et un éclat illumine son visage de soixante-dix ans. Pamela est une belle personne, captivante et elle a un charme de grand-mère.
Expédition seuls dans la jungle o͹ la pluie torrentielle de la veille a laissé ses traces. Fourmis rouges qui piquent, araignées colorées, mygales dévoreuses et poilues. Lézards qui se cachent dès que nos pas écrasent les feuilles qui jonchent le petit sentier. Gazouillements d’oiseaux étranges, glapissements d’aigles, coassements de grenouilles, bourdonnements divers, chants de petits perroquets verts en groupes, toucan perché qui nous regarde du haut de son long bec pointu et coloré. Sifflements de serpents, hurlements de singes, mimosa sensitif dont les feuilles se referment au moindre toucher pour se protéger des éventuels dangers. Grenouilles minuscules, fourmis qui portent, en file indienne, des feuilles trois fois plus grosses qu'elles. Un animal bizarre, mélange de sanglier et de lièvre, saute devant nous. Nous sommes perdus. Trois heures d’errance. Nous retrouvons enfin les baies paradisiaques de Manzanillo... (À suivre).
Périple costaricain (2)
Reprendre la route, quitter la pura vida des Caraͯbes pour celle du Pacifique en passant par les volcans du centre du pays. Turrialba, Poas, Arenal, etc. Malédiction ou malchance. Il aura fallu qu’on passe par lÍ pour que le volcan se mette en éruption. Le village est fermé, les habitants sont évacués. L'autre volcan se cache des vues sous une couronne de nuages. Son cratère est précieux, il ne se montre pas souvent. Mais dès qu’on lui a tourné le dos, un peu déçus, il a grogné. C’est un bruit bizarre. Mélange entre grognement et bruit de roches qu’on touille dans un récipient en acier. Énorme. Il est temps de partir et de quitter le monstre et ses hauteurs, ses nuages qui le préservent des regards curieux, ses orchidées blanches, roses et violettes, ses bambous et arbres géants. Sur la route vers l’ouest, le climat se fait plus sec et la nature un peu moins présente. Le vert est même teinté de jaune. Mais les montagnes sont aussi imposantes qu’ailleurs. Champs de café, de cacao, d’ananas, moins de cocotiers, on quitte les cÍ´tes. Arrêt obligé dans la petite bourgade de Caͱas. La ville est barricadée. Maisons sans jardin, façades de magasins, batiments, tout est grillagé jusqu’Í la toiture en tuile. Les gens se font rares, les regards plus curieux. Point de touristes. Soudain, une vingtaine de motards en cuir passent et perturbent un instant le calme de Caͱas. Les gens sont méfiants ici. Apparitions furtives, regards cachés derrière les barricades. On dirait une ville assiégée. Ville de trafics traversée par la route panaméricaine ?
Reprendre la route, zigzaguer, freiner, admirer ce paysage qui s’étend tel un Eden généreux. Des pancartes de candidats aux élections présidentielles surplombent la route. Ils sont quatre candidats dans la plus vieille démocratie d’Amérique latine et la seule qui a osé supprimer l’armée pour investir plus dans l’éducation. Les Ticos ne s’intéressent pas beaucoup Í la politique. Pura vida. L’actuel président, Oscar Arias, prix Nobel de la paix, n’a pas l’intention de se représenter. Les autres, faisant toujours partie de la vingtaine de familles les plus riches du Costa Rica, proposent des programmes divers. Luis Fishman le populiste table sur la sécurité et joue avec la fibre nationaliste pour pointer du doigt les Nicaraguayens qu’il accuse de délinquance. Ces derniers représentent 10% de la population et selon une étude du PNUD, 90% des infractions ont été commises par des Ticos… Bouc émissaire. Mais c’est Laura Chinchilla qui est favorite. Après le Chili, le Costa Rica ? Les femmes ici sont plus actives qu’ailleurs dans le monde, mais dans ce climat de pura vida, tout devient relatif. La majorité de cette gent féminine a un enfant avant l’age de vingt ans. Elle l’élève seule, le père doit lui passer un peu d’argent de temps Í autre. S’ils sont en famille, ils sont unis et leurs enfants sont leur richesse, leur fierté. J’ai cinq enfants, trois garçons et deux filles, nous lance fièrement un jeune homme proche de la trentaine...
On arrive Í destination. Samara est une petite ville jetée sur la cÍ´te Pacifique. Une ville de surfeurs, calme et touristique. Tout transpire la pura vida mais dans sa version moins agitée que Puerto Viejo et son ambiance rasta jamaͯcaine. La nature reprend vite le dessus. Singes hurleurs en grand nombre, papaye juteuse, mangue douce et crémeuse, ananas délicieux, jus de noix de coco frais. Pura vida. Premiers cours de surf. Le moniteur me demande d’o͹ je viens. De T͹nez. J’en ai jamais entendu parler, me lance-t-il avec indifférence. Les filles insistent du regard. La prostitution est légale ici. Des filles-mères au corps huilé, sculpté par les vagues du Pacifique et moulé dans un bikini string bronzent tranquillement sur les plages très larges du Pacifique en compagnie de leurs enfants de 5, 6, 7, 8 ans. La mer est calme le matin, les vagues se montrent avec la marée haute l’après-midi et avec elles, la horde de surfeurs. Les débutants se mettent Í l’affÍ»t de la première vague, les initiés attendent la plus grosse. Pura vida. Deux surfeurs québécois sortent de l’eau : « C’est ço la pouro vido man ! » dit le premier.
Le soir, une fête foraine, les paysans des quatre coins de la région affluent. Une corrida un peu trash. Ça suinte l’alcool. Ambiance d’émeute, de bagarre générale, de viol collectif sur les jeunes filles en short demi-fesse… rien de tout cela. Malgré la foule, l’alcool, l’adrénaline provoquée par les taureaux et canalisée par les rancheros, le sex-appeal des filles, rien ne se passe. Décidément, nous ne sommes pas en Égypte. Police présente partout, gilets par balles et mitraillettes. Hola, hola! Tout le monde se salue. Chouros chauds, boisson d’hibiscus, bière locale, grande piste de dance aménagée, etc. Pura vida.
Comme les éternels nomades, nous reprenons la route vers la capitale. Nous enchaÍ®nons les kilomètres, munis d’un GPS nord-américain non configuré sur les routes costaricaines et dont seul le localisateur nous permet de voir si nous sommes dans la bonne direction et quand il faut tourner. Arrivés Í la banlieue huppée Alajuela. Villas barricadées, grillages hauts couronnés de barbelés. De petites casernes dans ce pays sans armée. On nous conseille de circuler Í plus de deux personnes, de cacher tout signe de richesse, de mettre la voiture dans un abri gardé 24/24. Ambiance de guerre. On nous déconseille de traÍ®ner après 22h. Le centre-ville de San José est très animé. Plusieurs rues piétonnes s’entrecroisent. Des gens travaillent, d’autres se baladent. Très peu de touristes. Ces derniers préfèrent la cÍ´te et ne veulent pas s’aventurer dans cette ville Í la réputation dangereuse. On se sent bien ici, point d’insécurité. La police est partout. Les gens sont aussi souriants et chaleureux que sur les cÍ´tes. Le service est excellent dans les restos populaires du marché central. On se fond dans la masse. On passe pour des gens du coin. C’est l’accent qui nous trahit. Musée de l’or et de l’art précolombien. Architecture coloniale. Librairies, enfin, des livres!
Alé Abdallah